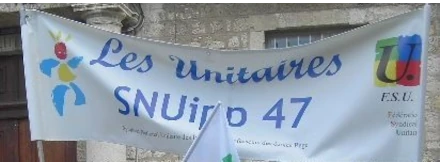La Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP) a publié le 01/03/2021, la note « Évaluations 2021 – Point d’étape CP : premiers résultats ». Elle précise qu’entre le 18 et le 29 janvier 2021, plus de 800 000 élèves de Cours Préparatoire dans plus de 32 000 écoles publiques et privées sous contrat ont passé une évaluation standardisée sur support papier.
Pourtant, si ces évaluations montrent quelque chose, c’est que les écarts entre les élèves de REP+ et ceux des écoles hors éducation prioritaire se maintiennent en Mathématiques et augmentent encore légèrement en Français. On peut par ailleurs s’inquiéter plus que jamais d’un resserrement de l’enseignement sur les items contenus dans ces évaluations, au cours de ces longs mois où le fonctionnement des écoles est entravé et où l’institution ne fait rien pour encourager les apprentissages culturels et les pratiques collectives à même de lutter contre les inégalités scolaires.
Commentaires généraux
Alors que la note de la DEPP de mars 2021 rappelle que les exercices choisis ne portent que sur 3 des attendus des programmes de Français et 4 en Maths, JM Blanquer affirme dans sa lettre aux enseignants du 9 mars et dans tous les médias, que les résultats « prouvent que tous ces efforts ont porté leurs fruits », que ces résultats sont significatifs du travail mené « de la petite section de maternelle au CM2 », cette évaluation n’a permis que de confirmer des difficultés d’élèves pour 78% des enseignant-es.
Et le Ministre annonce que la dynamique perceptible grâce aux évaluations doit s’accentuer, par « les modifications requises des pratiques » et la définition « d’objectifs pédagogiques concrets » confirmant ainsi les véritables objectifs de ces évaluations standardisées, imposer à tou-tes les enseignant-es des « fondamentaux » en lieu et place des programmes nationaux et imposer des « protocoles », dessaisir les enseignant-es de leur métier, qui consiste pourtant à construire les situations d’apprentissage les mieux adaptées à leur contexte de classe pour enseigner ces programmes.
À quoi servent les évaluations nationales standardisées ?
À exercer une contrainte très forte sur le travail des enseignants
Dans son analyse de mai 2019, le chercheur Roland Goigoux prenait l’exemple de la fluence pour alerter sur le pilotage de l’enseignement par les évaluations. Il écrivait « le ministère a délibérément choisi un seuil [de réussite] plus exigeant [en lecture à haute voix] pour des raisons stratégiques : imposer les ateliers de fluence présentés partout comme la nouvelle panacée de la pédagogie de la lecture, au risque de se substituer à tout l’enseignement de la compréhension ».
La note de la DEPP du 01/03/2021 précise que les inspecteurs de circonscription, dans leur grande majorité, estiment que le Point d’étape CP est un dispositif ayant de l’influence sur leur gestion des plans de formation et l’accompagnement des équipes respectivement à 94 % et 96 %. En français, la lecture à voix haute est le champ pour lequel les inspecteurs ont le plus souvent observé des modifications dans les pratiques enseignantes. Ainsi, la note précise : « La fluence, comme exercice de lecture, semble maintenant ancrée dans les pratiques enseignantes, puisqu’une majorité d’enseignants y ont recours ».
Concernant le lien entre fluence et compréhension en lecture, des chercheurs comme Sylvie Plane invitent à ne pas confondre corrélation et causalité. D’autres comme Eveline Charmeux alertent sur le risque que l’activité systématique de « déchiffrage oralisé », loin d’aider à la compréhension, puisse « faire écran au contraire à l’activité de construction des significations ».
La maternelle n’est pas épargnée par le pilotage des enseignements par les évaluations, puisque les inspecteurs déclarent privilégier l’utilisation des données de cette évaluation (de mi-CP) dans les concertations entre les cycles 1 et 2 pour 76 % d’entre eux.
Enfin, la DEPP présente ces évaluations comme devant « enrichir les pratiques des enseignants ». Rappelons que le rapport de l’IG 2019-096 d’octobre 2019 indiquait que les évaluations nationales standardisées avaient pour conséquences l’abandon des évaluations élaborées par les enseignants eux-mêmes et articulées aux progressions et aux pratiques de classe : « les évolutions apportées conduisent les enseignants à accepter et apprécier le dispositif proposé. Signe de cette appropriation, ils ont presque partout supprimé les évaluations locales qu’ils menaient antérieurement dans leur classe en début d’année et choisi de s’appuyer sur ce nouveau dispositif ».
Mesurer l’écart entre les élèves REP et les autres
La DEPP précise, au sujet des écarts entre élèves d’Education prioritaire et élèves hors Education prioritaire : « en Français, cela ne permet pas de retrouver les écarts de mi-CP 2020, en raison de l’augmentation des écarts observée en début de CP 2020 par rapport à 2019 »…
Si les écarts entre REP+ et hors Education prioritaire sont comparables entre 2020 et 2021 en mathématiques, on note quand même qu’ils atteignent 17,2 points pour la résolution de problèmes (17,1 en 2020), et 16,6 points pour la soustraction (16,7 en 2020).
En Français, les écarts entre élèves en REP+ et ceux hors Education prioritaire s’élèvent à 23,7 points pour une maîtrise satisfaisante de l’exercice « comprendre des phrases lues par l’enseignant » (l’écart était de 23 en 2020), à 17,2 points pour l’exercice « comprendre des phrases lues seul » (contre 15,4 en 2020).
Ces évaluations de milieu de CP confirment donc nos inquiétudes : à l’opposé de la communication de JM Blanquer, les notes successives de la DEPP montrent que les écarts de réussite s’accroissent entre REP+ et hors Education prioritaire. C’était le cas en septembre 2020, ce que l’on peut attribuer au moins en partie au confinement, mais c’était aussi le cas l’année précédente. En effet, Roland Goigoux l’avait dénoncé : « entre 2018 et 2019, les écarts passent (entre REP+ et Hors EP) de 14,5 à 15,2 points en fluence ; et de 31,1 à 32,4 points en vocabulaire. »
Par ailleurs, en Français (tous secteurs de scolarisation confondus) : l’exercice évaluant la lecture et la compréhension en autonomie de phrases est celui pour lequel la maîtrise est la moins affirmée (65,6 %).
En Mathématiques, tous secteurs confondus également et dans le domaine de la résolution de problèmes, les difficultés constatées en début de CP, comme en début de CE1, se confirment pour les élèves de CP à mi-parcours. Un peu plus de la moitié des élèves seulement (55,7 %) présentent une maîtrise satisfaisante. Il s’agit du domaine pour lequel le niveau de maîtrise est le moins affirmé.
De manière générale, des pressions sont exercées sur les enseignants pour qu’ils concentrent leur enseignement sur les « fondamentaux », autrement dit sur des compétences instrumentales. Or ces évaluations confirment que les compétences les moins maîtrisées par l’ensemble des élèves sont les compétences complexes : la compréhension en lecture, la résolution de problèmes en mathématiques. Enfermer les enseignants dans des approches centrées sur les compétences de bas niveau ne peut en aucun cas permettre à l’école de relever le défi de la démocratisation scolaire, et d’une culture commune ambitieuse pour tous les élèves.
Ce dont les élèves ont vraiment besoin
La situation est difficile dans les écoles, de nombreux élèves ont des difficultés avec leur "métier d’élève", de nombreux collègues parlent de "l’atonie" de leurs élèves. Il faudrait donc soutenir les démarches pédagogiques qui mettent les élèves en situation réflexive collective et qui visent à créer des climats de classes sereins, organisés autour de règles partagées et autour des apprentissages à construire.
À l’opposé, les évaluations standardisées portent sur des compétences instrumentales, mesurées de manière fragmentée. Ces évaluations non seulement n’aident pas les élèves mais détournent les enseignants de ce qu’il faut parvenir à mettre en place dans la classe. Ces évaluations ne portent que sur ce qui est mesurable dans les programmes. Elles écartent justement ce dont nos élèves ont besoin dans cette période si difficile : la découverte, la capacité à s’interroger, la dynamique collective qui permet d’inclure tous les élèves dans une vie de classe.
Ces évaluations induisent une approche faussement individualisée, puisque les "réponses" que l’enseignant doit proposer à l’issue des évaluations sont des réponses standardisées.
Par ailleurs, 6 800 postes de RASED manquent dans les écoles, comme manquent particulièrement en cette période de crise sanitaire les postes de remplaçants (210 suppressions ont encore été opérées à la rentrée 2020, malgré le contexte sanitaire). Les postes de « Plus de maîtres que de classes » ont également continué à être supprimés (-341 à cette rentrée, dont 91 en Education prioritaire), alors même que la note du comité national de suivi 2017 concluait que les élèves gagnaient en confiance et en autorégulation de leurs apprentissages et que ce dispositif contribuait à la fois à la réduction des inégalités scolaires, à l’amélioration du climat scolaire, à l’évolution des pratiques enseignantes et renforçait la dimension collective de l’école.
Une autre politique éducative est indispensable.
)