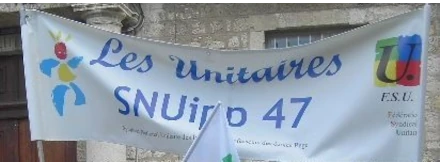Contexte
Le rapport pointe notamment l’impact économique de la sous représentation des femmes dans les métiers les plus rémunérateurs, privant « la société de l’apport d’ingénieures, de chercheuses, d’innovatrices » dont les effets estimés sur la croissance économique sont de l’ordre de 10 milliards d’euros par an.
Selon le rapport, cette sous représentation est due majoritairement aux stéréotypes de genre qui « engendrent [pour les filles] manque de confiance en soi et sentiment de ne pas être à sa place. »
En janvier 2025, l’Institut des politiques publiques écrivait dans une note sur le décrochage des filles en mathématiques que :
« L’écart en mathématiques en faveur des garçons apparaît en milieu d’année de CP et se creuse en début de CE1. Les filles perdent en moyenne 6 rangs par rapport aux garçons durant la première année d’école élémentaire. Des résultats identiques sont observés pour chacune des quatre cohortes étudiées : chaque année, y compris pendant les années 2019-2020 et 2020-2021 fortement affectées par la pandémie de Covid-19, les filles commencent à décrocher en mathématiques dès cinq mois après l’entrée en CP et ce décrochage se poursuit en CE1 (Breda, Sultan et Touitou, 2024). Le décrochage a surtout lieu parmi les filles les plus performantes en début de CP (celles qui font partie du top 1 % au début de CP). Ces filles perdent en moyenne près de 7 rangs en début de CE1 par rapport aux garçons appartenant au même centième initial.
L’évolution de l’écart en mathématiques entre les garçons et les filles s’observe dans toutes les catégories sociales et configurations familiales, et sur l’ensemble du territoire. Le décrochage des filles par rapport aux garçons est moins important dans les classes incluant surtout des filles ou quand l’enseignant est une femme plutôt qu’un homme, et quand l’école est localisée dans une zone réseau d’éducation prioritaire plus (REP+). »
La publication des données de la DEPP n°25.22, qui compare les résultats des évaluations nationales standardisées de 6e des élèves depuis 2017, montrent qu’en mathématiques les écarts entre les filles et les garçons se sont creusés en 8 ans de 10 points en défaveur des filles, pour les 10 % des filles et des garçons les plus performantes. Pour les autres, les écarts stagnent mais restent en défaveur des filles en mathématiques.
De nombreuses recherches ont été menées pour comprendre ce qui était à l’origine de cette situation. Elles montrent toutes que ce sont les stéréotypes de genre qui amènent des biais dans l’éducation des enfants mais aussi dans les pratiques enseignantes. A l’école, il y a une vraie contradiction entre le/la supposée élève modèle (attention, écoute, soin du matériel de l’écriture, capacité d’organisation…) et ce qui est finalement valorisé en classe puis dans l’accès aux études supérieures et aux métiers valorisés socialement (leadership, compétition, dépassement de soi…).
À l’école, les recherches montrent que les comportements des filles sont poussés vers l’élève modèle alors que les comportements des garçons sont valorisés dans le sens du leadership. Jacques Gleyse, notamment, parle de programmes cachés :
« À titre d’exemple, parmi de nombreux autres programmes cachés d’éducation, on peut constater que [dans] un cours de mathématiques l’enseignant pose des questions plus complexes aux garçons qu’aux filles. Les enseignantes et enseignants font plus de remarques d’ordre disciplinaire mais aussi cognitives aux garçons qu’aux filles ; les filles et les garçons ne sont pas punis de la même manière ni pour les mêmes types de fautes. En EPS, les enseignantes qui constituent des groupes de niveau font en général un groupe fort constitué essentiellement de garçons et un groupe faible composé essentiellement de filles. Les professeures des écoles (GLEYSE, 2020,) pour les élèves entre 5 et 8 ans, croient à la supériorité des garçons en mathématiques, alors qu’en réalité à cet âge les études ne montrent aucune différence de performance en mathématiques des filles et des garçons. »
Dans son contenu, le plan compare les pourcentages de filles dans les filières scientifiques au lycée et en études universitaires « 42 % des filles suivent l’enseignement de spécialité mathématiques en terminale, elles ne représentent que 25 % des étudiants qui intègrent des formations supérieures conduisant aux métiers d’ingénieurs et du numérique ».
Il pointe aussi l’apparition du décrochage des résultats des filles en mathématiques dès le premier trimestre du CP se creusant tout au long de la scolarité.
Compte tenu de toutes ces données, on peut aisément voir un lien de causalité entre le déploiement des politiques blanquériennes qui aggravent le tri des élèves, et le creusement des inégalités filles/garçons en mathématiques depuis 2017.
L’orientation des filles vers les métiers les moins rémunérateurs est qualifié de choix, ce qui laisse pour le moins circonspecte dans la mesure où il est établi largement que ce sont les stéréotypes de genre qui produisent la perte de confiance des filles dans leur capacité à s’orienter vers les métiers les plus rémunérateurs. Par ailleurs, s’il est vrai que les filles s’orientent vers des métiers moins rémunérateurs, on omet de prendre en charge le fait que ces métiers sont moins rémunérateurs car ils sont , précisément, faits par des femmes.
S’il est important de permettre aux filles d’accéder aux métiers scientifiques, il est tout aussi important que les garçons s’orientent vers les études de langues et de sciences sociales puis vers des métiers actuellement majoritairement exercés par les femmes. Or, ce pendant n’est jamais traité.
Pourtant, il est nécessaire de questionner les deux aspects, sinon on n’enrayera pas la hiérarchisation des genres, et les salaires des femmes resteront en dessous des salaires des hommes.
Contenu du plan
Les propositions d’actions du plan reposent sur 3 piliers :
- Pilier 1 : former et sensibiliser les personnels de l’éducation nationale
- Pilier 2 : renforcer la place des filles dans les enseignements qui ouvrent vers les filières d’ingénieur et du numérique
- Pilier 3 : ouvrir les horizons des jeunes filles et susciter des vocations
Pilier 1
La première mesure du pilier 1 est de faire bénéficier toustes les professeures de l’Éducation nationale d’une sensibilisation aux biais de genre de 2h avant le 15 septembre 2025 animée par les directeurices. « Cette sensibilisation s’appuiera sur les indicateurs statistiques propres à chaque établissement ». Le regard spécifique des indicateurs locaux pourrait entraîner d’autres biais ne permettant pas aux personnels de transformer leur pratique alors que les recherches montrent très largement que « l’école est en réalité un système contribuant à la reproduction des inégalités filles-garçons (femmes-hommes) en faveur des garçons (hommes), notamment à travers sa fonction de sélection et l’instauration d’un climat compétitif, difficilement conciliables avec les valeurs stéréotypées transmises par la socialisation féminine. » (Alyson Sicard, Céline Darnon & Delphine Martinot, dans Genre et scolarité).
La deuxième mesure est un plan de formation pluriannuel (sur 4 ans) afin que toustes les professeures des écoles aient une journée de formation visant « à analyser les gestes professionnels, faire prendre conscience des risques de reproduction involontaire qui apparaissent par exemple dans la gestion des prises de parole en classe ou dans les appréciations portées sur les bulletins scolaires. »
Pour la FSU-SNUIPP, un plan de formation est une bonne chose mais une formation d’une journée semble bien insuffisante au regard des enjeux de transformation sociale sous-jacents. Pour être agissant, un travail long sur l’impact des stéréotypes sur les pratiques enseignantes à l’œuvre sur la pédagogie mais aussi sur la didactique est à mener par l’ensemble des enseignantes.
De plus, la forme et le contenu de la formation seront aussi très importants pour faire bouger les pratiques enseignantes. Les formations m@gistère ne permettent pas de questionner suffisamment et collectivement les pratiques de classe.
Enfin, si la gestion des prises de parole et les appréciations sont effectivement à questionner, il faut aussi questionner les attentes (souvent inconscientes) des professeures qui divergent envers les élèves en fonction des disciplines mais aussi du niveau scolaire. Ainsi, puisque qu’une enseignante a des attentes moindres pour les filles en mathématiques alors il/elle limitera ou se « satisfera » d’acquisitions moyennes. Cela est aussi agissant pour les élèves des classes populaires et les élèves racisées. Ainsi, une fille racisée et pauvre subira X fois plus les effets des stéréotypes de genre et aura X fois moins accès aux parcours scientifiques qu’un garçon.
La troisième mesure est l’affichage d’une charte de lutte contre les stéréotypes qui devra être affichée en salle des maitresses. Elle « rappellera les points de vigilance pour mieux prévenir la reproduction des stéréotypes ».
Pour la FSU-SNUipp, le fait d’inscrire dans une charte la lutte contre les stéréotypes tend à pointer du doigt la responsabilité, consciente ou non, des enseignantes, se rapprochant d’une forme de prof bashing alors que l’institution a en main depuis plus de vingt ans les résultats des recherches sur le sujet et aurait pu transformer la formation des personnels, promouvoir les pédagogies égalitaires ou critiques de la norme depuis longtemps. Cela aurait contribué à faire baisser les effets des stéréotypes dans leurs enseignements.
Pilier 2
Les mesures du pilier 2 - toutes axées sur le second degré ou les Classes préparatoires aux grandes écoles - sont peu coûteuses en moyens et ne toucheront qu’une très faible partie des filles. Les filles défavorisées et racisées n’en bénéficieront pas.
Pilier 3
La mesure du pilier 3, « la mise en place de rencontres systématiques avec des rôles modèles de la 3e à la terminale », est reconnue comme permettant d’ouvrir le champ des possibles mais elle arrive bien tardivement dans la scolarité pour avoir du poids pour l’ensemble des filles. C’est dès la maternelle que des rôles modèles multiples et ne répondant pas aux stéréotypes de genre doivent être mis en avant pour les filles, mais aussi pour les garçons.
Le rapport de France Stratégie (« Lutter contre les stéréotypes filles-garçons. Quel bilan de la décennie, quelles priorités d’ici à 2030 ? », mai 2025), montre qu’il devient urgent de lutter globalement contre les stéréotypes liés au genre, afin d’éviter le risque de double polarisation de la société.
En effet, si les représentations stéréotypées ont reculé chez les adultes depuis 20 ans, une enquête sur les 11-17 ans a montré que ces dernieres ont une vision stéréotypée des rôles sociaux.
De même, l’adhésion aux rôles sociaux stéréotypés est plus forte chez les garçons que chez les filles.
Pour le haut commissaire au plan « l’impératif d’une politique publique de lutte contre les stéréotypes plus ambitieuse, plus constante et plus globale » est une certitude. Pour les rapportrices, l’école est un des leviers mais les 20 propositions formulées vont au-delà, notamment vers la petite enfance. Enfin, les enjeux liés au numérique, en particulier les réseaux sociaux, sont forts tant ils agissent « comme une arme de construction massive des stéréotypes de genre ».
Il est donc évident que ce plan tel qu’il est proposé est largement insuffisant. Des moyens en nombre doivent être abondés pour transformer la formation des enseignantes afin qu’elles et ils acquièrent dès l’entrée dans le métier, puis tout au long de celui-ci, les pratiques qui permettent de mettre en œuvre la pédagogie critique de la norme. C’est parce qu’il est primordial de conjuguer la lutte contre les inégalités de genre avec la lutte contre les inégalités de classe et de race que ces mesures sont insuffisantes. C’est l’ensemble du système éducatif actuel qu’il faut transformer afin d’en
supprimer les hiérarchies entre élèves, entre et à l’intérieur des classes et des établissements.
La réduction des inégalités liées au genre, à la classe ou à la race ne peut se faire sans lutte contre les discriminations. Le code pénal doit être connu et respecté au sein des écoles, cela peut passer par l’ajout d’un article dans le règlement intérieur de l‘école.
Enfin, le pilotage par les évaluations et la promotion des performances mesurables, chronométrées, privilégiant la compétition, développés depuis 2017, ne sont pas sans effet sur le climat scolaire et le rapport à l’école des enfants. Comment ne pas voir que ces repères et critères de réussite correspondent aux stéréotypes genrés masculins, qui favorisent donc les garçons ? Pour la FSU-SNUipp, la question suivante devrait se poser : doit-on acclimater les filles à un environnement compétitif, ou y renoncer pour tous les élèves, filles et garçons ?
)